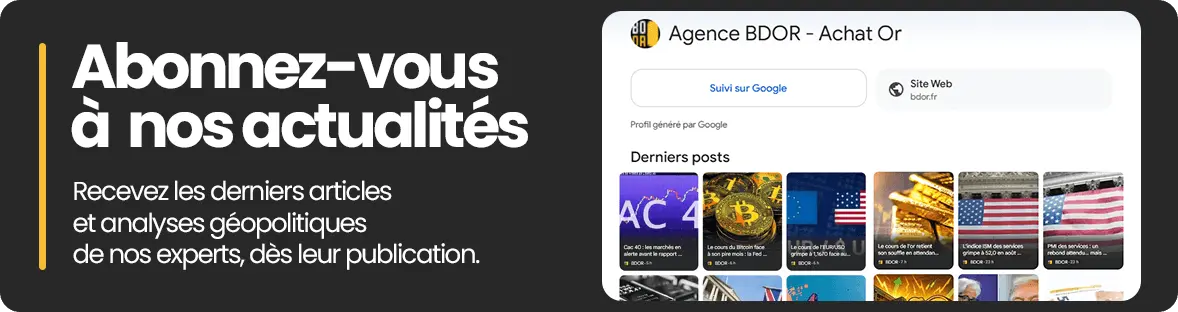En bref
Une hausse de 0,5 % des allocations chômage actée pour juillet 2025
Une mesure décidée sans débat ni prise de position du gouvernement
2,1 millions de bénéficiaires concernés, pour un coût estimé à 58 millions d’euros
Un déficit de 300 millions d’euros prévu en 2025
Une gouvernance éclatée, sous pression budgétaire, sans ligne politique claire
Une hausse budgétaire minime qui pèse lourd politiquement
Le 25 juin 2025, le Conseil d’administration de l’Unédic a adopté une revalorisation des allocations chômage de 0,5 %, applicable dès le 1er juillet. Derrière cette mesure qualifiée de technique se cache un choix éminemment politique, rendu plus visible par l’absence totale de réaction du gouvernement. Aucun ministre, aucun parlementaire ne s’est exprimé sur le sujet. Ce silence, dans un pays où l’emploi reste une priorité affichée, agit comme un aveu.
A lire aussi : Pendant que l’État garde le silence sur le chômage, le cours de l’or explose face aux tensions monétaires !
Ce sont 2,1 millions de personnes qui verront leur allocation légèrement évoluer. La somme minimale passera à 32,13 €, la partie fixe de l’ARE atteindra 13,18 €, et le plancher dégressif sera porté à 92,57 €. Des montants revus à la marge, dans une logique d’équilibre financier, sans ambition sociale.
Une gouvernance paritaire sous tension
Officiellement, l’Unédic revendique son indépendance et sa gestion paritaire, assurée par les organisations syndicales et patronales. Mais le vote à la majorité qui a entériné cette revalorisation de 0,5 % reflète des désaccords profonds entre les partenaires sociaux. Plusieurs voix ont exprimé leur désapprobation, dénonçant une mesure trop faible face à la réalité de l’inflation.
Le coût estimé de cette revalorisation est contenu : 58 millions d’euros pour l’année 2025, un montant bien inférieur aux hausses précédentes (+1,2 % en 2024, +1,9 % à deux reprises en 2023). La contrainte budgétaire a donc prévalu, au détriment d’un soutien réel aux chômeurs.
Un silence politique qui en dit long
L’absence de débat sur cette décision contraste avec les revalorisations passées, bien plus visibles. Cette fois, pas de prise de parole, pas de confrontation d’idées, pas même un commentaire. Le sujet, pourtant sensible, a été relégué au second plan. Et ce désengagement n’est pas anodin.
Selon notre expert : Chômage figé, dette publique en hausse... et l’or devient la seule valeur refuge des épargnants prudents ?
L’exécutif avait pourtant fait du plein emploi une priorité. Pourtant, face à cette mesure structurante, le gouvernement reste en retrait, laissant les partenaires sociaux assumer seuls la communication et la mise en œuvre. Un retrait stratégique qui brouille les responsabilités et évacue tout débat public sur le sens de la solidarité.
Une équation budgétaire impitoyable
Cette prudence s’explique. Deux semaines avant l’annonce de la hausse, l’Unédic révélait ses projections pour 2025 : 300 millions d’euros de déficit et une dette de 59,8 milliards. Des chiffres alarmants qui ont clairement influencé les arbitrages du Conseil d’administration.
Mais la conséquence directe est une stagnation du pouvoir d’achat pour les chômeurs. L’exemple de Marie, 35 ans, mentionné dans le communiqué officiel, illustre ce déséquilibre : avec 6 € de plus par mois, son allocation passe de 1 200 € à 1 206 €, bien loin de suivre le rythme de l’inflation.
Des règles prolongées, une réforme suspendue mais pas abandonnée
Depuis l’adoption de la convention du 15 novembre 2024, l’Unédic fixe seule les règles du régime. Pourtant, le gouvernement conserve un levier d’action en prolongeant ces règles par décret, comme il l’a fait jusqu’à fin 2024. Ce pilotage indirect maintient une forme de contrôle étatique sans visibilité publique.
La réforme de l’assurance chômage, officiellement suspendue depuis l’été dernier, n’a pas disparu. En ne tranchant pas ouvertement, l’exécutif évite d’assumer une décision potentiellement impopulaire, tout en préparant déjà les futurs ajustements.
Une mesure modeste, mais au poids symbolique lourd
Seulement 40 % des inscrits à France Travail perçoivent une allocation, selon les derniers chiffres de la DARES. Ce chiffre, à lui seul, rappelle la fragilité du système. Dans ce contexte, la hausse de 0,5 % semble dérisoire, presque cynique, au regard des enjeux sociaux.
Ce micro-ajustement agit comme un révélateur : celui d’un modèle en tension, suspendu entre équilibre budgétaire et exigence de solidarité. La question reste entière : jusqu’à quand l’État continuera-t-il à se retrancher derrière la gouvernance paritaire pour éviter d’assumer ses choix sociaux ?